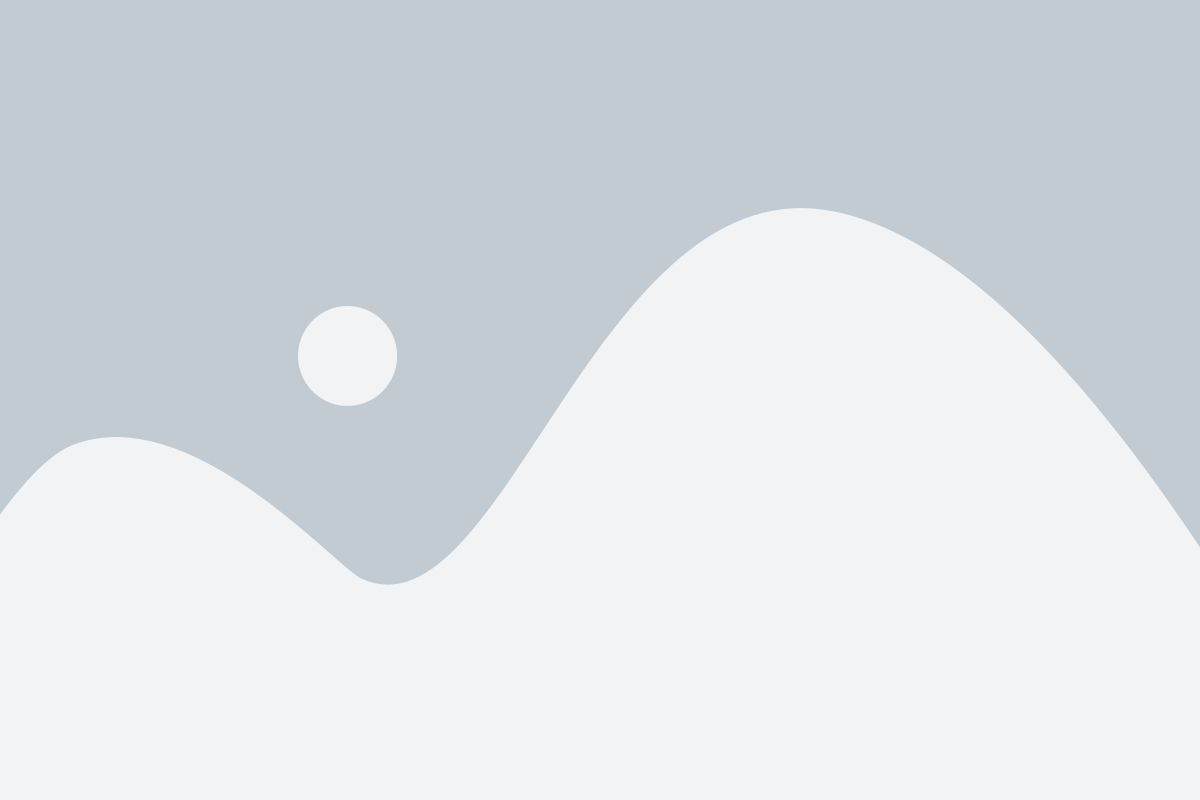Culture du commandement et facteurs humains
Une recherche ancrée à l'Ecole navale
L’équipe de recherche s’inscrit dans le contexte de l’Ecole navale, qui forme les élèves-ingénieurs de l’Ecole navale proprement dite et les autres officiers de la Marine nationale, ainsi que les élèves de l’Ecole de manœuvre et de navigation, qui forme notamment au métier de chef de quart à bord des navires. S’y ajoutent des formations spécifiques pour des étudiants, des cadres de la société civile ainsi que des officiers à certaines étapes de leur carrière. Les objectifs de la recherche sont en prise avec les visées et les contenus de ces formations. Cette recherche se nourrit de la relation privilégiée de l’Ecole navale avec les différentes composantes de la Marine.
Cultures du commandement
Dans ce contexte, la notion de commandement recouvre un vaste ensemble thématique, dans le registre de la connaissance de l’environnement stratégique, institutionnel, géopolitique et opérationnel, des activités professionnelles des chefs militaires et des compétences techniques, sociales et humaines qu’elles mobilisent, des comportements individuels et collectifs qui conditionnent les pratiques dans un contexte historique et culturel donné. La formation humaine des officiers constitue l’un des enjeux de la recherche.
Les recherches sur le commandement portent sur sa dimension culturelle et les compétences réflexives qu’il demande. Elles visent à étudier les éléments constitutifs des identités professionnelles et des cultures de métier qui structurent les conceptions contemporaines du commandement dans la Marine française et, par comparaison, celles des organisations nationales et internationales équivalentes. Elles s’appuient sur la compréhension des phénomènes de conflictualité maritime et les représentations du combat, qui conditionnent et définissent les attentes en termes de compétences de commandement. Il s’agit enfin de comprendre en quoi le retour d’expérience des opérations conduites nourrit les représentations professionnelles, développe une culture propre et soutient la réflexion sur les conflits futurs.
Facteurs humains
Ces recherches portent également sur les caractéristiques de la personne du chef militaire et ses compétences humaines dans le registre de la maîtrise de soi et de l’exercice de l’autorité dans les équipes. Elles visent à étudier ce que sont les qualités morales attendues aujourd’hui des officiers et les ressorts individuels et collectifs sur lesquels elles s’appuient, dans le domaine des valeurs et des principes, de la motivation et de l’engagement, de l’endurcissement physique et mental. Ces études prennent en compte les cursus propres des cadres militaires, les évolutions relatives de la société militaire et de la société civile. De ce fait, une attention particulière est apportée aux figures de chefs de la Marine.
Au-delà, les recherches portent sur la place et le rôle de l’humain dans les environnements sociotechniques navals et les compétences organisationnelles et décisionnelles attendues des chefs militaires. Elles visent à étudier les systèmes sociotechniques complexes caractérisés par la haute technologie, l’adaptation des organisations et les diverses contraintes du milieu, au regard des activités professionnelles et des nouvelles modalités de commandement qu’elles impliquent. Cette approche sociotechnique permet notamment d’analyser les rapports entre concepteurs et utilisateurs des systèmes navals dans les démarches d’innovation. L’étude des systèmes navals prend ici en compte la Marine dans son environnement stratégique, institutionnel, scientifique et industriel. Ces recherches permettent de comprendre en quoi les transformations techniques suscitent des transformations à la fois dans le domaine de la stratégie navale, dans l’organisation des bâtiments et dans les pratiques de commandement à bord.
En complément, ces recherches explorent les processus cognitifs mobilisés lors des interactions sociales complexes inhérentes aux diverses situations dans lesquelles les chefs militaires sont amenés à prendre des décisions.
La décision constitue la dimension performative du commandement, sa manifestation concrète et observable. Elle est étudiée comme telle, à la fois comme acte psychocognitif et sociocognitif, comme geste professionnel et comme fait social et politique, à différents niveaux (micro, méso, macrosocial). Elle s’inscrit dans un cadre institutionnel évolutif et adaptatif, marqué par les rapports entre concepteurs et utilisateurs des systèmes navals.
Dans la chaire Résilience et Leadership
Les chercheurs impliqués dans la chaire s’intéressent plus particulièrement au commandement dans les situations complexes critiques à fort degré de risque, caractérisées par l’imbrication de multiples données observables et d’objectifs à atteindre, par l’incertitude que génère le non observable autant que les biais qualitatifs et quantitatifs de l’information, par l’urgence de la décision et, pour le marin, par le stress, la surcharge émotionnelle et cognitive, et la nécessité constante d’améliorer ses capacités d’analyse.
Dans la chaire NAIADE
Les chercheurs impliqués dans la chaire NAIADE (Navalisation de l’1ntelligence Artificielle pour l’Aide à la Décision) s’intéressent aux transformations qu’amène le développement de l’IA sur les activités, les compétences et les organisations collectives des marins. Les interactions humain/machine, les critères d’acceptation, les formes de coopération et les modes de décision sont les questions plus particulièrement étudiées.
Approche pluridisciplinaire
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de recherche s’inscrit dans une approche résolument pluridisciplinaire au sein des sciences humaines et sociales, en étant centrée sur les objets d’étude. Elle s’appuie sur différentes épistémologies : histoire, psychologie, sociologie, sciences politiques, sciences de gestion, stratégie navale. A ce titre, elle associe les méthodes quantitatives et qualitatives sur des données textuelles, les enquêtes de terrain, l’analyse des pratiques sur les retours d’expérience opérationnelle, et les démarches expérimentales.
A travers différents projets menés au sein de l’Irenav et en partenariat avec d’autres établissements d’enseignement supérieur, elle s’inscrit également dans une démarche pluridisciplinaire avec les sciences de l’ingénieur, et intègre des comparaisons et des approches croisées avec d’autres domaines professionnels.